Avec Raphaël Stevens, Pablo Servigne a publié en 2015 Comment tout peut s’effondrer, petit traité de collapsologie à l’usage des générations présentes. Livre conceptuellement important pour les décroissants parce qu’il nous obligeait à nous redéfinir : là où les « objecteurs de croissance » se contentent de critiquer la croissance, en y voyant certes un problème mais en ne proposant finalement comme solution que de mettre fin à la croissance, de dire adieu à la croissance, les décroissants font déjà un pas supplémentaire en signalant que le problème n’est pas tant la croissance que le fait que la croissance dépasse les plafonds de soutenabilité écologique → il ne s’agit plus alors politiquement d’arrêter la croissance mais de repasser sous ces plafonds, de préconiser donc des diminutions, de PIB, de niveau de vie (à ne pas confondre avec « qualité de vie »), d’extraction, de production, de consommation, de déchets.
Mais ce petit traité de collapsologie allait encore plus loin : il ne s’agit de pas de repasser démocratiquement sous les plafonds de la soutenabilité écologique, comme si au retour d’une mauvaise excursion, nous pourrions retrouver le havre de la maison. Car il y a des limites qui une fois franchies au-delà d’un certain seuil d’effondrement sapent les conditions même d’un retour à la situation d’origine : je vais même plus loin en voyant un risque d’effondrement non pas seulement du côté des conditions écologiques mais aussi du côté des conditions qui rendent possibles une vie sociale.
Avec Gauthier Chapelle, Pablo Servigne a publié en 2017 L’entraide, l’autre loi de la jungle. Ils reprenaient là la voie ouverte par Pierre Kropotkine : L’entraide, un facteur de l’évolution (1906) 1. Là encore, les décroissants pouvaient retenir deux leçons : 1/ Assez finement, les auteurs n’opposent pas frontalement « loi du plus fort » et « loi de l’entraide » mais ils font remarquer que si la compétition peut s’installer dans les temps d’abondance, tout au contraire « un milieu hostile et/ou compétitif pouvait favoriser l’apparition de l’entraide » (page 300).
Il y avait là un apport crucial pour la décroissance quand on définit cette dernière comme la réorientation sociale de la gestion des surplus : de l’appropriation au profit d’une minorité de privilégiés vers une dépense collective (sur cette question, les (f)estives de 2017 sont déterminantes). 2/ Mais à l’influence d’un milieu hostile, Chapelle et Servigne ajoutait une deuxième force évolutive dans l’apparition des comportements altruistes : la sélection de groupe → dans la sélection naturelle, « ce sont les groupes les plus coopératifs qui survivent le mieux » (page 238). Là encore, quand on voit dans la décroissance autant une doctrine écologique qu’une doctrine sociale, alors il y avait de quoi renforcer l’argumentation en faveur d’une décroissance ayant comme objectif la conservation, la protection et l’entretien de la vie sociale.
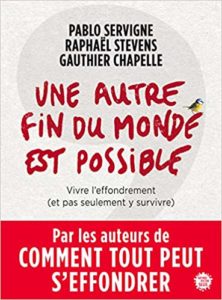
C’est donc avec appétit que l’on peut retrouver Gauthier Chapelle, Pablo Servigne et Rapahël Stevens, réunis pour l’écriture d’Une autre fin du monde est possible (2019). Mais nous ne cacherons pas cette fois-ci notre déception. Dès le titre : pourquoi un tel singulier alors que le pluriel « d’autres fins du monde sont possibles » aurait manifesté l’ouverture aux défis qui ne manqueront pas de s’imposer quand sera venu l’époque de la post-décroissance. Par « post-décroissance » – plutôt que par l’expression de « post-croissance » – nous entendons rappeler que, quand les plafonds de soutenabilité écologique sont dépassés, quand ces dépassements dépassent à ce point les bornes qu’ils sapent la possibilité d’une conservation des conditions sociales et écologiques de la vie humaine, alors LA question politique c’est celle des trajets pour repasser démocratiquement sous les plafonds.
Aujourd’hui, nous vivons dans la croissance et son monde (et nous rejetons ce monde) ; nous croyons désirable des mondes où chacun vivra POUR et AVEC les autres (plutôt que CONTRE ou SANS les autres) ; mais entre le rejet du monde actuel et le projet des mondes désirables, il va falloir une transition, un trajet ← c’est cela très précisément qui est la décroissance. C’est donc après la décroissance que viendra le temps de co-construire d’autres mondeS possibleS.
Cette question du trajet est une question politique.
C’est cette question qui semble totalement écartée dans cet ouvrage. Et la déception du titre se poursuit dans celle du sous-titre : « Vivre l’effondrement ». Car, en effet, si l’effondrement est déjà là alors la question du trajet ne se pose plus. Qui irait chercher sa hache si l’arbre est déjà tombé ? Reconnaissons que cet oubli de la question politique apparaissait déjà dans les 2 précédents ouvrages ; mais là il ne s’agit plus d’oubli, mais bien d’une prise de position. Quand la collapsologie devient collapsosophie (troisième partie), ce pourrait être une si belle occasion d’affirmer le nécessaire fondement spirituel de toute politique – parce qu’aujourd’hui la politique se réduit au calcul des moyens et des ressources alors la décroissance tente au contraire de réhabiliter une conception plus idéaliste de la politique redéfinie à partir des finalités, d’un idéal du Bien en commun… – mais malheureusement l’ouvrage ne ressemble fichtrement qu’à un catalogue de recettes psychologiques.
Nous ne voulons pas dire que la question politique devrait refouler la question des conditions psychologiques mais rappeler qu’il y a quelques risques de manquer une critique radicale de l’individualisme s’il s’agit seulement de « vivre l’effondrement ». De ce point de vue, nous devons être resté quelque peu marxiste : « Ce n’est pas la conscience qui détermine la vie mais la vie qui détermine la conscience ». Certes là où Marx n’envisageait que des déterminations sociales pour conditionner la conscience, les décroissants ajoutent que les déterminations écologiques conditionnent les déterminations sociales qui conditionnent la vie individuelle.
Notre critique est très exactement la suivante : nous ne doutons pas un seul instant de l’enthousiasme vécu par les auteurs dans des expérimentations personnelles et collectives mais nous ne croyons pas qu’un « profond changement de conscience, d’un changement intérieur » (page 280) constitue en quoi que ce soit une condition pour entreprendre sans attendre non seulement les luttes contre les destructions de ce qui reste de monde commun et de vie sociale mais surtout le travail théorique de rupture avec les cadres intellectuels et affectifs qui organisent aujourd’hui le monde de la croissance.
Au doute sur la suffisance de la collapsosophie comme condition des ruptures et des trajets, nous ajoutons même la crainte qu’à proposer ainsi des voies psychologiques de résilience, de telles pratiques ne fassent que renforcer le monde qu’elles prétendent refuser. Quand nous lisons (page 271) que « les compétences de vie en groupe seront également vitales, tout comme l’apprentissage de la vie en milieu sauvage », nous ne pouvons qu’être choqué : le milieu sauvage, c’est précisément ce milieu où nous ne devons pas vivre, ni individuellement ni collectivement, en dehors de toute rêverie et de toute robinsonnade.
In fine, j’ai personnellement quelque réticence à adopter le point de vue de celui qui voit ce que les autres ne verraient pas. Ce que je vois aujourd’hui, ce n’est pas tant l’effondrement que l’incroyable résilience d’un monde capitaliste qui propose profusions d’alternatives vécues comme désirables, que je juge personnellement aliénantes tout en constatant que mon jugement est loin d’être partagé. Il ne fallait pas désespérer Billancourt ; il ne faut toujours pas désespérer les collapsologues.
---------------Notes et références

Parler de post décroissance quand on ne sait pas comment organiser la décroissance parait osé, mais cela conforte bien l’idée de trajet nécessaire, à assumer collectivement. Le texte serait une bonne base politique, mais il désespère à la fin les amoureux de la vie sauvage et assassine le chasseur-cueilleur qui sommeille en nous.