Par temps de déconfinement, il est encore possible de partager quelques discussions politiques. Et donc d’en tirer quelques réflexions.
Les lundi 24 et mardi 25, nous étions quelques décroissants de la MCD à participer aux journées d’été du PEPS (Pour une écologie populaire et sociale), près de Die (dans la Drôme).
Les samedi 29 et dimanche 30, Thierry Brulavoine et moi avons participé à un séminaire organisé par le Réseau des territorialistes, à Saint-Antoine l’Abbaye (dans la Drôme).
Et du jeudi 20 au dimanche 23, nous étions une bonne dizaine de décroissants, à Charpey (dans la Drôme), pour une rencontre « organisationnelle » de la MCD.
Bref, nous étions dans la Drôme. Et nous avons pourtant évité 1 les rencontres de LFI qui avaient lieu, en même temps, à Chateauneuf-sur-Isère (dans la… Drôme).
Il y a quelques années, j’avais commis un petit livre pour réfléchir aux conditions idéologiques pour penser et faire la transition : Politiques de la décroissance (aux éditions Utopia, 2013). J’y défendais une sorte de « trépied » pour tenir à égale importance le pied des luttes, le pied des alternatives concrètes et le pied du projet. Le temps passant, je ne suis plus sûr du tout de réécrire aujourd’hui le même livre, en tout cas son chapitre 12 dans lequel je mettais les 3 pieds… sur le même pied. Pourquoi ? Parce que quelques années de militantisme plus tard m’ont appris la faiblesse sinon le déni du pied (du travail de projet) idéologique chez beaucoup de nos amis militants politiques.
L’anti-intellectualisme sous la forme du spontanéisme
Ce déni – mais c’est peut-être juste une paresse – est quelquefois ouvertement anti-intellectualiste, mais la plupart du temps il prend la forme de la tentation du spontanéisme.
Le spontanéisme des luttes
Ce spontanéisme des luttes peut trouver sens dans la perspective d’une « convergence des colères » et des ressentiments. Dans ce cas, la parole du militant de la rue prendra sans coup férir le dessus sur la moindre réflexion intellectuelle, surtout si celle-ci est argumentée et nourrie de critiques, de contre-critiques et d’autocritiques. Le plus drôle (ou le plus désespérant) est de voir la réaction de l’intello placé en confrontation avec le militant : plutôt que de tenter l’autorité des arguments, il se réfugie dans la position détachée de l’observateur (comme si cette neutralité affichée n’était pas démission !).
Lors des journées du PEPS, je ne sais pas si la fécondité des discussions informelles toujours possibles entre les nombreux ateliers (carrés) et tables rondes (qui se  se sont succèdés à un rythme effréné, en concurrence les uns avec les autres) suffit à effacer le sentiment de gâchis devant les pseudo-débats entre participants aux interventions juxtaposées qui ne semblent être là que pour permettre à « la salle » d’accaparer la majorité du temps de parole (au point de se demander s’il ne faudrait pas mieux éviter d’être invité pour avoir vraiment la possibilité de s’exprimer).
se sont succèdés à un rythme effréné, en concurrence les uns avec les autres) suffit à effacer le sentiment de gâchis devant les pseudo-débats entre participants aux interventions juxtaposées qui ne semblent être là que pour permettre à « la salle » d’accaparer la majorité du temps de parole (au point de se demander s’il ne faudrait pas mieux éviter d’être invité pour avoir vraiment la possibilité de s’exprimer).
J’ai pu ainsi assister à un débat sur l’écoféminisme dans lequel toute possibilité d’engager vraiment les enjeux politiques de l’écoféminisme a semblé impossible. Les deux intervenantes étaient pourtant réellement pertinentes mais chacune est bien restée enfermée dans son « rôle » : pour l’une, l’écoféminisme a plus semblé un objet d’observation philosophique qu’un sujet d’engagement politique. Pour l’autre, la lutte sur le terrain – le front de mères – a paru se réduire à une lutte NIMBY sans aucune portée réellement générale – sinon, celle de faire exemple.
Comment ne pas rester ébahi de voir la « victoire » se réduire à un remplacement des ascenseurs dans une tour d’une quinzaine d’étages, sans que jamais ne soit même évoquées les conditions politiques générales qui ont amené des populations entières à devoir se loger dans de telles tours de béton ? Bien sûr, la vie, et même la vraie vie, peut toujours s’y retrouver mais ne vaudrait-il pas mieux que ces luttes du quotidien – menées dans ce cas par des mères – s’ouvrent immédiatement à l’horizon d’une lutte en faveur d’une ville plus vivable, moins artificialisée ?
Dans un autre registre, j’ai participé à un débat sur les perspectives politiques de l’après (confinement). Passe encore d’avoir dû subir les discours rodés des missi dominici d’EELV venues d’ores et déjà engager toute discussion politique sur un seul terrain : le vote utile, dès le premier tour de la prochaine présidentielle de 2022 en faveur de LEUR candidat. Mais devoir subir les interventions de plus jeunes nous faisant la leçon sur la force des révoltes sociales récentes, nous expliquant que nous devions ranger nos vieilles discussions idéologiques pour « se rassembler », se fédérer » derrière les gilets jaunes, les comités Adama, , le mouvement Me Too et la jeunesse pour le climat n’a pas été facile ; pas même eu l’occasion de leur rappeler que – d’expérience, si, si – nous commençons à savoir qu’une révolte est loin d’être automatiquement un « mouvement social » ; car pour l’être, il ne suffit pas d’être « indigné », il faut encore que la révolte ait au moins en vue une vision générale de ce que devrait être une société transformée.
Et là c’est bien de théorie qu’il s’agit : au sens de « vision » de ce qu’il serait préférable d’espérer. Faute d’une telle end in view, comment ne pas se rendre compte que le seul levier politique qui peut rester est le rapport de forces : mais comment une telle perspective pourrait-elle devenir réalité si les mêmes qui revendiquent le rapport de forces s’interdisent en même temps de renforcer ce rapport en incluant toute lutte particulière dans un mouvement plus ambitieux ? Il ne s’agit donc pas, sur le terrain des luttes, de se passer de rapports de forces, il s’agit juste de ne pas oublier que si rapport de forces il doit y avoir alors il serait contradictoire de ne l’envisager que dans un périmètre réduit : si la division vient de ceux même qui s’engagent dans la lutte, il y a de quoi désespérer.
A contrario, ne serait-il pas plus réaliste, dès qu’un conflit est engagé, même au niveau le plus local, d’accepter de placer en horizon une extension du domaine des luttes ? Autrement dit, pas de « fin du mois » sans horizon de risque de « fin du monde ».
Le spontanéisme des alternatives concrètes
Quant à l’autre forme de spontanéisme, le spontanéisme des alternatives concrètes, il peut trouver sens dans la perspective des fables de l’essaimage/masse critique/bifurcation. Avec le spontanéisme précédent, il y a tout un jeu de similitude et d’opposition. D’un côté, le « contre » des luttes et le « pour » des expérimentations semblent pouvoir faire front commun contre la politique réduite à sa dimension électoraliste ; on y retrouve aussi le même anti-intellectualisme accusé de vouloir toujours trop vite généraliser aux dépens de la particularité des expériences alternatives.
Sauf que, faute de théorie, la seule voie d’une généralisation à d’autres doit du coup passer par l’exemplarité : comme s’il suffisait de vouloir être imité pour garantir la validité sociale d’une expérimentation sociale minoritaire ! Dans un monde qui se meurt d’individualisme, comment ne pas s’inquiéter t’entendre les « porteurs de projets » alternatifs nous expliquer que « par un saut de conscience », c’est la prise de conscience individuelle 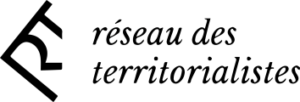 qui pourrait devenir ferment suffisant de transformation sociale.
qui pourrait devenir ferment suffisant de transformation sociale.
D’un autre côté, et comme pour rajouter une couche de validité à leur démarche, les promoteurs de la suffisance des « alternatives » affichent des valeurs « positives » : plutôt que de continuellement s’opposer par des contre et des anti, il faudrait – pour être du côté de la vie – être du côté de la construction. Je ne cache pas que cette « positivité » affichée – cette « non-violence » mise en avant, dans son clivage avec la violence des luttes et des rapports de forces – me semble plus relever de l’auto-illusion et de la fable que d’une réelle possibilité de porter le danger contre la société dont ils prétendent s’éloigner en se réfugiant au sein des « oasis ».
Pour le suggérer plus philosophiquement, le fond individualiste de beaucoup de ces défenseurs des alternatives me semble reposer sur une grave contradiction dans le rapport aux autres : plus exactement, dans le déni ou l’oubli de la sensibilité à l’altérité irréductible de l’autre. Je ne vois pas comment on peut affirmer que le rapport à autrui commence par le rapport à soi et continuer à prétendre être capable de pratiquer la bienveillance à l’égard d’autrui, surtout quand on réalise que la bienveillance ne peut pas ne pas commencer par la réception de l’altérité d’autrui. Faute d’une telle sensibilité/humilité – cette irréductible altérité de l’autre est source d’une indisponibilité de l’autre – répétons que le seul type de « relation » à l’autre ne peut plus être que l’imitation, celle de l’exemplarité : l’autre ne semble pouvoir exister que s’il devient contradictoirement… le même. C’est Hartmut Rosa qui nous explique que dans ce cas, la relation n’est plus qu’écho 2 et certainement pas « résonance ».
Le péril de cette mise en écho de la relation aux autres, c’est la « communauté terrible » (Tiqqun 2 3), la « dissociété (Jacques Généreux) : car si on ne fait de la politique que pour les gens qui pensent comme nous, alors c’est l’existence même du politique – dans sa défense acharnée de la pluralité pour la pluralité – qui semble impossible, sinon inutile.
A contrario, à cause de cette irréductible altérité d’autrui, une politique réellement bienveillante à l’égard d’autrui ne devrait-elle pas faire des autres – le voisin, le concitoyen, l’émigré, l’étranger… – les objets mêmes de notre sollicitude ? Je crois que même les plus individualistes des individualistes pourraient reconnaître que leur existence ne dépend pas que d’eux mais toujours d’une base sociale à partir de laquelle ils tentent de s’élever. Mais alors comment être socialiste ? Et bien en ajoutant à cette reconnaissance envers la sphère de la reproduction sociale la volonté de faire de (la persévérance de l’existence de) la vie sociale l’objectif politique de toutes nos alternatives.
Ainsi vivre en société n’indique pas seulement une condition humaine – notre condition sociale – mais fournit aussi une finalité, un sens. Alors, effectivement, la mobilisation portée par les alternatives ne serait pas du seul ressort de la répulsion contre/anti tel ou tel mode de vie, mais trouverait son moteur dans l’attirance vers un idéal de projet de société : faut-il alors ne pas s’interdire la théorie d’un tel projet !
En se privant volontairement ou non d’une telle vision idéologique/théorique, les alternatives qui se prétendent « concrètes » ne sont en réalité qu’abstraites, au sens où abstraire, c’est extraire, séparer : il faut en réalité beaucoup d’insensibilité aux autres pour prôner la « sécession » (alors que le capitalisme n’est qu’une organisation généralisée de la séparation 4.)
Pour un aggiornamento de la décroissance
Mais alors en quoi les décroissants peuvent-ils prétendre échapper à ce spontanéisme à double face ? Sans nier l’utilité ni des luttes ni des alternatives, il convient juste de ne pas se laisser berner par leur suffisance ; et par contrecoup il convient de critiquer leurs insuffisances et leurs manques, de théorie et d’idéologie en particulier. Et d’affirmer tout aussi clairement, que même – miracle ! – en position d’hégémonie culturelle, nos théories et nos idéologies ne pourraient se passer ni de luttes ni expérimentations alternatives.
C’est pourquoi la sorte d’aggiornamiento que j’ai proposé pendant nos rencontres organisationnelles de la MCD me semble – dans la perspective des considérations critiques précédentes – permettre d’articuler clairement ce que depuis plusieurs années je repère comme rejet, trajet et projet.
Pourquoi ne peut-on plus en rester à l’abstraction de la décroissance comme « mot-obus » ?
Un premier point de départ est une interrogation sur la difficulté de tant de militants engagés dans des résistances d’accepter une reconsidération des vieilles catégories critiques du 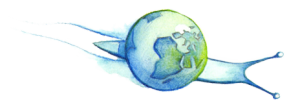 capitalisme (et c’est ainsi que même chez des « productivistes solidaristes » (selon la classification de Xavier Ricard-Lanata), nous pouvons trouver des nostalgiques du travaillisme et de l’étatisme).
capitalisme (et c’est ainsi que même chez des « productivistes solidaristes » (selon la classification de Xavier Ricard-Lanata), nous pouvons trouver des nostalgiques du travaillisme et de l’étatisme).
Du côté des expérimentations alternatives, cette difficulté peut se traduire par un double rejet : a/ du monde de la croissance (rejet que nous partageons) et b/ de toute politique (rejet que nous ne partageons pas du tout). Ce rejet de la politique s’effectue souvent en deux temps : a/ réduction du politique à l’électoralisme ; b/ pseudo réhabilitation du politique (non politicien) mais dans un sens si général et si vague qu’il a perdu toute force mobilisatrice (car tout serait ainsi toujours déjà politique). Alors qu’au contraire, nous voulons faire de la politique un contenu de notre volonté, plus exactement de la volonté générale.
Un second point de départ découle de ce que nous apprenons déjà de la période du confinement : pendant le deuxième trimestre 2020, la PIB aurait décru de presque 13,8 %. Or, en tant que décroissants, pour repasser sous les plafonds de la soutenabilité écologique, ce n’est pas de 13,8 % qu’il faudrait décroître mais de 300 %, c’est-à-dire 13,8% pendant 2 années de suite. Quand on voit les dégâts sociaux déjà subis par les plus faibles, est-il raisonnable de prétendre répéter l’opération 8 fois de suite ? Suffit-il d’affirmer que nous prendrions aux plus riches pour éviter de tels dégâts ? Et puis quel pouvoir politique – auquel de toutes façons nous n’avons pas accès – pourrait imposer démocratiquement une telle potion amère ? Nous ne pourrions décroître que de 5% par trimestre, il faudrait encore 5 ans ! La question de l’imposition démocratique d’une telle décroissance se fait encore plus aigüe. 10 % par an : il faudrait 11 ans.
Je n’en tire pas la conclusion que l’objectif d’un facteur 4 de décroissance est utopique, j’en tire juste la conclusion qu’une décroissance démocratique ne doit jamais oublier de rester et réalisable et désirable. Une telle décroissance serait facilitée en commençant par les secteurs les plus évidemment inutiles : http://decroissances.ouvaton.org/2016/02/22/comment-imaginer-la-vie-quotidienne-apres-la-decroissance/#1_Ce_qui_doit_decroitre.
Le monde post-décroissance serait plutôt le même monde, la croissance en moins
Le troisième point de départ est qu’il y a deux façons différentes d’esquiver la question de la transition, celle de la décroissance comme trajet démocratique. C’est de s’enfermer dans le rejet et c’est de s’évader dans un projet inaccessible.
J’ai donc proposé de réviser à la baisse notre façon de penser la rupture, de cesser de se raconter que le monde idéal que nous appelons de nos volontés politiques serait un tout autre monde que celui dans lequel nous vivons aujourd’hui et que nous voulons quitter.
D’abord parce qu’il y a une sorte de mirage de l’alternatif : après tout, le capitalisme, phase après phase, résilience après résilience, crise après crise, ne cesse de devenir un autre capitalisme : il ne cesse de s’adapter 5. Ensuite, la prise en compte du flux du temps devrait nous rendre plus modeste en termes d’alternative : parce que le temps qui passe, c’est toujours déjà un autre qui s’installe et, en même temps, un même qui continue. On ne repart jamais de zéro, d’une tabula rasa ; et on ne reste jamais inchangé. Il ne s’agit donc pas pour les décroissants de devoir trancher entre la tradition et le progrès, il s’agit pour eux d’avoir l’audace politique de se demander : que devons-nous garder (protéger, conserver, entretenir) de cette société que nous critiquons pourtant radicalement ?
Bref, assumons de n’être ni des réactionnaires ni des progressistes, mais des conservateurs révolutionnaires. Notre rêvolution ne rêve donc pas d’autres mondes possibles, mais du même monde que celui dans lequel nous vivons. Il est déjà tellement riche de différences. Plutôt que de chercher à en inventer sens cesse de nouvelles, nous devrions tout faire pour transmettre parmi celles qui existent déjà, toutes celles qui favorisent la continuité de la vie sociale et de la nature. Mais avec une très grande différence : ce serait le même monde mais avec la croissance en moins. Dans L’âge des low-tech, Philippe Bihouix fait remarquer qu’un monde idéal ne serait pas sans voiture ou sans machine à laver, mais ce serait des 4 L en propriété d’usage commun, des lave-linge à 2 programmes là aussi en utilisation partagée… Nous serions donc des conservateurs, mais communistes 6.
En rabaissant ainsi nos illusions de ruptures, nous ramenons le souhaitable dans la sphère du désirable. Quand le projet est à portée de main, alors le trajet peut main-tenant s’envisager.
La décroissance devrait donc défendre une politique du moins ; même pas du mieux ou de l’autre ; juste du moins.
Mais comment ne pas s’apercevoir qu’une telle politique du moins nous permettrait de retrouver la maîtrise de nos temps de vie ?
Une politique du moins serait donc une politique du temps, voilà ce qui serait désirable. Retrouver le temps de vivre , de vivre le temps de persévérer dans nos existences.
Les notes et références
- En fait, nous n’étions pas invités[↩]
- L’écho n’est pas seulement la répétition du même, il est aussi l’inévitable épuisement de cette répétition.[↩]
- https://communautedeschercheurssurlacommunaute.wordpress.com/retour-sur-la-communaute-terrible/[↩]
- « Cette séparation, qui est à la base de toute société où certains exercent le pouvoir sur d’autres, atteint son point culminant sous le capitalisme », 5ème thèse sur l’anti-pouvoir chez John Holloway, http://1libertaire.free.fr/JHolloway01.html[↩]
- https://www.youtube.com/watch?v=NeBWN9rMKMs[↩]
- http://decroissances.ouvaton.org/2020/08/30/la-double-dynamique-vertueuse-du-commun/[↩]
