Clément Sénéchal, Pourquoi l’écologie perd toujours (2024), Seuil.
Le titre est attirant parce qu’il sort de cette ambiance bienveillante et même irénique au sein de la mouvance écolo, qui voudrait que même les critiques les plus acerbes devraient se plier à une formulation cool. D’autant que la critique vient d’un connaisseur de l’intérieur puisque Clément Sénéchal a été porte-parole de Greenpeace. Ce qui explique en particulier cette première partie si bien informée sur les logiques, on devrait dire les psychologiques, qui ont conduit à l’avènement de cette ONG sur la scène médiatique.
C’est un livre de journaliste dans la mesure où son texte est avant tout un récit bien informé, une chronologie des interventions accomplies au nom de ce qu’il appelle une « écologie du spectacle » (p.17).
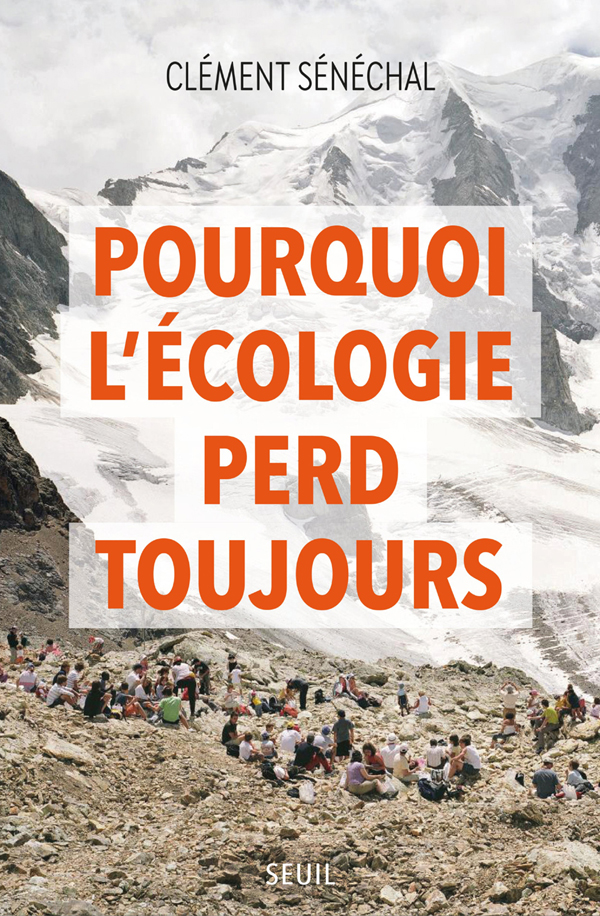
- Le titre : « Si cette écologie fabrique de l’échec, c’est parce qu’elle se vend à tous » (p.80). C’est parce que dès les premières campagnes de Greenpeace (Nucléaire, baleines, phoques, les 3 premiers chapitres), le mouvement environnemental moderne a constitué « une sorte de « troisième voie » avant l’heure, qui va déporter la controverse politique en dehors de l’affrontement entre capital et travail, au nom d’une défense œcuménique de la nature » (p.22).
- Le diagnostic : « Depuis des années, les écologistes partagent en définitive le même agenda que la classe capitaliste. Conséquence d’un champ social qui s’est construit en dehors des mouvements ouvriers et des classes populaires, ils ont codé leurs revendications dans la langue du marché » (p.100).
- La thèse : « En déréalisant le contenu social et politique des enjeux environnementaux, l’écologie du spectacle amène l’écologie d’opportunisme » (p.77).
- La solution : « Seule la constitution d’un front populaire peut armer sérieusement le rapport de force écologique… La tâche de l’écologie consiste alors à cultiver la conscience de classe et à enrichir la réflexivité du champ social pour s’intégrer pleinement dans les batailles de l’émancipation. En l’occurrence : la bataille ouvrière, la bataille décoloniale, la bataille féministe » (p.194-195).
- Le plan : la première partie est consacrée à l’apparition « réussie » de Greenpeace. La deuxième partie (chapitre 4 à 7) suit chronologiquement « l’impuissance organisée » de l’environnementalisme contemporain » : Macron et Hulot, l’Affaire du Siècle et le Grand Débat, Plus jamais ça, la Primaire populaire. Dans la dernière partie, l’auteur prophétise « la mort de l’environnementalisme » : l’acte de décès (chapitre 8, essentiellement consacré à la dernière campagne européenne des écologistes) annonce selon lui « les nouveaux victorieux » (chapitre 9).
Les facettes de l’écologie qui perd
Pour cerner les critiques que Clément Sénéchal adresse à une certaine écologie, le plus amusant est de relever les qualificatifs qu’il emploie, et ils sont explicites.
« Quand la cause environnementale prend la forme du spectacle, la radicalité se cantonne donc invariablement au sensationnalisme… [comme s’il suffisait] de montrer les choses pour les changer. L’écologie du spectacle peut alors ne se revendiquer d’aucun camp, puisqu’elle flotte au-dessus de la réalité sociale » (p.57-58).
« Un environnementalisme œcuménique, compassionnel et moralisant, surpassant la conflictualité de classes dans un universalisme abstrait largement occidentalo-centré. Un environnementalisme individualiste aussi… » (p.62).
A propos de Nicolas Hulot : « une écologie de la figuration » (p.75).
A propos des ONG : « elles ont fini d’édifier une écologie dépolitisée, situant le rapport de force dans une confrontation illusoire entre quelques activistes notoires et des mastodontes économiques plutôt que dans la construction politique » (p.92).
« Les écogestes renvoient à une écologie du luxe et de la volupté, cultivée comme un art de vivre raffiné, innocemment teinté de mépris de classe, calibré pour les adeptes du bio et du vélo électrique » (p.95).
« A l’instar des syndicats réformistes, la société civile environnementale ne prend pas parti. Elle propose une écologie qui s’abstient. Une écologie qui a le temps, parce qu’elle a de l’argent » (p.143).
« L’écologie institutionnelle cherche encore à « convaincre le gouvernement » et entretenir le récit d’une transition pourtant introuvable. Elle se condamne ainsi à refluer vers sa zone de confort, où elle ne surprend plus personne et finit de dépolitiser son objet » (p.148).
A propos de Greenpeace et des Amis de la Terre : « elles vont se concentrer essentiellement sur une version édulcorée de leur répertoire d’action classique : le banderolisme et le spectacle de rue » (p.161).
« Une écologie récréative se répand dans l’espace public. Dans les modes de représentation choisis, sur le ton de l’humour ou de la farce, l’écologie du spectacle renchérit. Un peu comme si, face à l’échec général, elle ne faisait même plus semblant de faire semblant » (p.165).
A propos du « plaidoyer » : « on croit dans un premier temps que la communication sert les objectifs de campagne ; on finit par s’apercevoir que les campagnes servent essentiellement à communiquer… L’approche du plaidoyer elle-même affaiblit la conscience des enjeux, en ce sens qu’elle pousse à la spécialisation par thématique » (p.172). « Le plaidoyer constitue donc l’envers du spectacle » (p.174).
L’activisme comme nouvelle radicalité
Mais alors que serait selon l’auteur une écologie qui gagnerait1 ?
« La rue comme rampe de lancement d’une écologie enfin majoritaire ? Au moins fait-elle sortir l’écologie de ses anciennes figures imposées pour l’inclure dans le répertoire d’action élémentaire de la contestation. Force en mouvement, elle commence à acquérir une valeur politique réelle » (p.102).
A propos d’Extinction Rebellion (XR), et de Dernière Rénovation (DR) ou Just Stop Oil, qui sont des « mouvements déprofessionnalisés, décloisonnés et plus spontanés dans leurs moyens… Décentralisé, horizontal, sans dirigeants ni porte-parole attitrés, le mouvement propose une écologie inclusive à un nouveau public souvent méfiant envers les vieilles structures » (p.106).
A propos des marches climat et des grèves de la jeunesse : « la cause s’ouvre enfin et la perspective d’un front utile au rapport de force écologique semble se profiler » (p.108).
A propos des Soulèvements de la Terre (SLT) qui « prennent leur essor, en popularisant des luttes clairement situées dans une rupture avec le régime capitaliste. Peu à peu, on voit l’écologie du clivage s’imposer sur l’écologie du consensus » (p.149). « Ils assument ainsi le fait que l’écologie relève d’une guerre de position2 : afin de défaire l’emprise économique du capitalisme et dépasser les postures défensives, il faudra bien reprendre la terre, au sens propre, pour gagner » (p.180).
« Dans une certaine mesure, les appels au calme et à la non-violence qui quadrillent le répertoire de l’écologie assermentée doivent être questionnés… En définitive, l’acquis stratégique le plus prometteur des SLT réside dans le renversement d’hégémonie qui s’opère au sein du champ environnemental. C’est l’entrée en majorité du « flanc radical » » (p.182-183).
« Seules les classes populaires… incarnent la possibilité d’une authentique révolution progressiste… Sans elles, sans leurs colères, nul potentiel de changement radical » (p.195).
« D’où la nécessité d’une écologie décoloniale et antifasciste… d’une « écologie pirate » » (p.198).
Une écologie LFI réussira-t-elle mieux qu’une écologie BCBG ?
Que penser et du diagnostic et du remède ? Que nous partageons le premier mais que nous sommes plus circonspects quant au second.
Pourquoi ?
- Parce qu’il faut craindre que ces discussions sur la stratégie politique ne tournent en réalité en rond. La solution de Clément Sénéchal propose de passer d’une stratégie de consensus à une stratégie de clivage. Mais n’est-ce pas oublier que si les voies du « petit geste » (du colibri) ont été ré-explorées, c’est parce que les stratégies de rupture ont été des impasses ? Pour le dire autrement, c’est l’échec de la révolution du Grand Soir qui a ré-enclenché les tentatives des petits matins et des petits pas. C’est l’échec révolutionnaire du socialisme scientifique (front principal, luttes des classes, matérialisme historique) qui a redonné vigueur aux stratégies « alternatives » du socialisme utopique3.
- D’autant que l’auteur ne manque pas de reprendre la critique facile contre la transition en tant que telle (p.158, note 2). Qu’il n’y ait jamais eu de transition énergétique au sens de remplacement d’une source par une autre mais toujours addition (c’est la thèse de J-B Fressoz), ne permet pas d’en déduire que l’on passera d’un paradigme à un autre d’un « claquement de doigts ». Or précisément, le refus lucide d’un changement par claquement de doigts, c’est l’effet d’une guerre de position que l’auteur défend par ailleurs.
- On retrouve dans ce livre le même chaud-froid que celui que provoquait le passage du chapitre 4 au chapitre 5 du livre de l’Atelier Paysan, Reprendre la terre aux machines. Car passer de la dénonciation de l’apolitisme assourdissant de la stratégie des « alternatives » à la reprise de la croyance que les « luttes-contre » permettraient de provoquer les changements que les « luttes-pour » n’auraient pas déclenchées, c’est, répétons-le, tourner historiquement et politiquement en rond.
- Dit encore plus clairement : ce n’est pas parce que l’écologie va devenir anticapitaliste qu’elle va réussir au lieu de toujours perdre. Et complétons : ce n’est pas parce que l’anticapitalisme va se verdir qu’il va réussir là où, lui aussi, il a toujours échoué.
*
Comment peut-on justifier une telle sévérité vis-à-vis de la voie entrouverte par l’auteur ?
- D’abord, en se rendant compte que finalement l’opposition centrale de son livre entre deux types d’écologie ne se déroule qu’au sein d’une seule question : celle de la visibilité politique. Et que le propos de l’auteur est de réhabiliter ce qu’Alain Krivine nommait en 1974 « la jambe de la rue ». Mais si nous reprenons la distinction entre « trois pieds » – celui de la visibilité, celui des alternatives et celui de la théorie – alors il faut constater que le pied de la théorie reste dans ce livre toujours bancal.
- Ensuite, en tant que partisan de la décroissance comme trajet – c’est-à-dire comme « mot-échafaudage » et surtout pas comme « mot-obus » – il faut aller jusqu’à étendre le plus loin possible la critique contre la croissance : ne pas se contenter d’une critique économique (l’anticapitalisme), ni même d’une critique socioculturelle (la croissance comme monde avec ses modes de vie, ses attachements, ses imaginaires, ses normes…) mais aller jusqu’à une critique politique.
- Il nous faut insister là sur ce qu’Hartmut Rosa nomme une « serious question: Is modern society, then, equivalent to capitalist society? Do I simply mean “capitalism” when I refer to the basic structure of modern society? The answer is : capitalism is a central motor, but dynamic stabilization extends well beyond the economic sphere” 4.
- Ce n’est donc pas en reprenant la grammaire de l’activisme anticapitaliste que l’écologie pourrait être victorieuse. Que les luttes soient nécessaires, bien sûr. Mais il faut dire d’elles ce que nous disons des « alternatives » : elles sont nécessaires mais insuffisantes.
- Car seule une critique politique peut permettre de voir dans la croissance économique et dans son monde non pas une cause mais un effet, non pas la maladie mais un symptôme. La maladie c’est le « régime de croissance ». Or nous avons montré par ailleurs que ce régime de croissance repose à la fois sur un horizontalisme et sur un activisme. Croire donc que l’on va échapper à la structuration descendante de l’écologie de consensus en passant à une écologie de clivage qui serait à la fois horizontale et activiste, c’est rester sous l’emprise du régime de croissance : et c’est donc continuer de chérir les causes dont on dénonce les effets.
*
Notes sur « la décroissance comme stratégie »
« Quelle stratégie politique pour une décroissance concrète ? »
Sur l’injonction au concret.
- Qui repose sur une inversion par amalgame. Car en amalgamant le « concret » à l’action, on fait dire au concret le contraire de ce qu’il dit normalement. En français, « concret », c’est le contraire de « abstrait »5. Et abstraire, c’est extraire, c’est « séparer », c’est « isoler », c’est « faire abstraction ». Bref, on « abstrait » quand on sépare une partie d’un tout. Pour savoir alors si une « action » peut être concrète, il faut se demander si une « action » peut être suffisante. Et là, il faut répondre que non. Tout simplement parce qu’aucune action n’a de sens par elle-même. Pour qu’une action ait du sens, il lui faut s’intégrer entre un « espace d’expérience » et un « horizon d’attente » (pour reprendre les catégories de Reinhart Koselleck, dans Le futur passé (1990), éditions de l’EHESS). Dit autrement : pour qu’il y ait « action », il faut qu’il y ait discussions sur l’héritage et sur la perspective. La conséquence de ce rappel lexical est rude : la plupart des « alternatives » qui se prétendent concrètes sont en réalité abstraites parce que ce sont des « impolitiques ». Une décroissance concrète est alors une décroissance qui ne fait aucune impasse sur la théorie, sur le besoin d’une conception…
- Sur l’injonction à l’activisme. Quand on étend la critique de la croissance jusqu’au « régime de croissance », alors on peut reprendre des analyses qu’Onofrio Romano présente dans sa Critique du régime de croissance (2024, Liber). Les deux faces du régime de croissance sont la croissance économique et l’individualisme : la croissance est la promesse faite à l’individu de disposer d’une infinité de ressources comme moyens au service de ses finalités privées. L’un des effets de ce deal libéral (tant économique que culturel et politique), c’est le neutralisme et l’horizontalisme institutionnels, c’est-à-dire la mise en équivalence généralisée de tous les jugements qui sont ainsi nivelées en tant que simples « opinions ». D’où le paradoxe relevé par O. Romano (op. cit., p.76-77) : si dans la modernité, chacun est invité à donner à sa vie son propre sens, alors plus personne ne peut l’imposer aux autres. « Avec la modernité, la reconnaissance de la microliberté devient un veto à l’endroit de la grande liberté collective ». Mais alors, par exemple dans une discussion, comment trancher quand les institutions prétendent se retrancher dans la neutralité ? Par le teukein, qui en grec ancien renvoie à la notion d’action tout autant qu’aux moyens d’intervenir efficacement dans le monde à la poursuite d’objectifs utiles au bien-être de l’humanité, qui assure sa légitimité par la puissance dont il fait preuve sur le terrain. Et c’est ainsi que le teukein prend la place du legein dans la vie en société moderne, que l’action prend le pas sur la théorie, que le faire de la technique remplace l’agir de la politique.
- Et c’est ainsi que l’injonction au concret prétend justifier politiquement les stratégies par essaimage ou percolation ou agglutination, en idéalisant les fameuses « alternatives concrètes ». Se met alors en place tout un « récit » – une story faute d’une Histoire – dont les séquences sont : prise de conscience → préfiguration → essaimage → masse critique → bifurcation.
Sur ce qu’est une « stratégie ».
- Commencer par cesser de confondre entre un scénario et une stratégie. Un scénario est une prédiction qui prétend être une prévision, sinon une prophétie. Une stratégie est une vision d’ensemble qui coordonne théorie et pratique. Confondre stratégie et scénario, c’est risquer de prendre ses désirs pour des réalités, c’est tomber dans la rhétorique impolitique de la fatalité et de la nécessité. Surtout si un scénario est inéluctable, alors toute stratégie devient inutile. Et réciproquement : aucune stratégie ne peut prétendre inéluctablement réussir.
- Cette distinction permet de cadrer avec précision quels pourraient être des rapports clairs entre décroissance et effondrement. Car la décroissance est une stratégie alors que l’effondrement est un scénario. Luc Sémal propose une distinction qui me semble particulièrement féconde entre une « décroissance par anticipation » et une décroissance en catastrophe ». Sans tomber dans le catastrophisme, comment nier aujourd’hui la montée en puissance (ou en impuissance, d’ailleurs) des effritements ? Et plus ces effritements s’installent plus la décroissance par anticipation recule au profit de la catastrophe. Autrement dit : moins il y a de stratégie et plus il y a de scénario.
- Cette distinction rappelée, on peut alors faire l’inventaire des différentes stratégies possibles. Je renvoie ici à la lecture critique de ce qui me semble une tentative particulièrement intéressante de penser une articulation de plusieurs types de stratégies : celle de Jérôme Baschet dans Basculements, Mondes émergents, possibles désirables (2021), La découverte6.
- Surtout ramener toute stratégie à la modestie de ne pas se prendre pour un scénario : ce qui permettra de revenir au concret de ce que l’on peut « préparer » sans se raconter qu’on pourrait ou le « prévoir » ou le « provoquer » Car c’est dans la préparation – fût-ce de la révolution au sens de Castoriadis – que la décroissance peut trouver ce que l’on appelle aujourd’hui de l’agentivité (de la robustesse plutôt que de l’efficacité).
Sur la décroissance comme « trajet ».
- Ce qui suppose d’accepter de ne voir dans la décroissance qu’une transition, qu’une période intermédiaire (une « époque », une parenthèse) entre le monde d’aujourd’hui (à qui nous adressons nos objections de croissance) et d’autres mondes possibles (que nous englobons comme « post-croissance »).
- Comment alors ne pas déplorer que cette décroissance stricto sensu est, même parmi la mouvance qui reprend le terme de décroissance, régulièrement oubliée sinon écartée au profit de visions iréniques du monde réel ! Car dans le monde réel, il faut quand même singulièrement être enfermé dans une bulle (rose ou noire) pour se raconter que la décroissance est inéluctablement en marche7.
- C’est donc pour aborder ces questions plus avec gravité qu’avec légèreté qu’à la MCD, nous réfléchissons à ce que pourrait être une stratégie réellement concrète de décroissance. a) Pour cela nous nous imposons une exigence : ne pas se raconter qu’il suffirait qu’une proposition soit « faisable » ou « désirable » pour qu’elle soit ipso facto « acceptable ». C’est en ce sens que nous voulons penser la décroissance comme « faisceau de trajectoires » : c’est pour cela qu’il ne suffit pas de faire l’inventaire de toutes les propositions actuelles mais qu’il faut les discuter systémiquement8. b) Pour les discuter, on ne peut se dispenser d’un cadre : aujourd’hui à la MCD, nous le basons sur un triple renversement, de la religion de l’illimitisme, de l’individualisme, de l’économie politique de la rareté. c) Il est alors possible d’aller au concret des « problèmes » plutôt que de raconter qu’il y aurait d’abord des solutions. Et pour affronter politiquement ces problèmes, nous croyons plus en la robustesse de matrices que dans le pseudo-concret de recettes qui seraient à essaimer : d’où nos réflexions sur la double autolimitation plancher-plafond, sur la « part » et sur le « lieu ».
*
Dans le langage courant, le couple concret-abstrait se superpose au couple matériel-intellectuel. Il y a donc dans l’appel à une « décroissance concrète » un risque d’anti-intellectualisme qui est d’autant plus dangereux a) que l’horizontalisme du régime de croissance peut dégringoler en populisme anti-intellectuel (« assez de blabla, passons à l’action ») et b) qu’au bas de cette dégringolade anti-intellectuelle, il peut y avoir la tentation de réduire la décroissance à un déterminisme matériel, physicaliste.
Alors qu’il faudrait, plutôt que de dégringoler, remonter la pente, par des « savoirs ascendants ». Vers où ? Vers une dimension spirituelle de la décroissance, qui passerait par la puissance imaginative des concepts, par des conceptions, qui assumerait la question décisive du « quand bien même » (qui est une expérience contrefactuelle de pensée), qui ferait ainsi de la décroissance une stratégie du sens.
Notes et références
- Je renvoie ici à l’intervention de Thierry Brulavoine, au nom du MOC, à NDDL le 6 juillet 2014, intervention que nous avions coécrite : https://ladecroissance.xyz/2014/07/05/2-aeroports-de-trop/#2-_Quest-ce_quune_victoire_pour_quelle_ne_devienne_pas_une_defaite).[↩]
- C’est Gramsci qui introduit en stratégie politique la distinction militaire entre guerre de mouvement et guerre de position. Ce qui caractérise la guerre politique de mouvement c’est a) que son front principal des luttes est l’infrastructure économique et b) que les contradictions internes du capitalisme faciliteront une victoire en un éclair et de façon définitive. Au contraire, la guerre de position a) s’attaque aux superstructures de la société civiles qui b) ne s’effondreront pas d’un claquement de doigts. Pour Gramsci, « la guerre de position, en politique, c’est le concept d’hégémonie ». Les stratégies de « convergences des luttes » et de l’essaimage tiennent plutôt de la guerre de position.[↩]
- Michel Lepesant, « Le socialisme utopique : ressource de la décroissance » dans Entropia n°10, printemps 2011.[↩]
- Harmut Rosa, « Dynamic Stabilization, the Triple A. Approach to the Good Life, and the Resonance Conception », Questions de communication, vol. 31, n°1, 2017, pp. 437-456[↩]
- Consulter l’article « concret sur le site CNRTL.[↩]
- [1] https://decroissances.ouvaton.org/2022/07/11/jai-lu-basculements-de-jerome-baschet/[↩]
- La MCD, conclusion intermédiaire de La décroissance et ses déclinaisons (2022), Utopia, p.92-94).[↩]
- D’où la lecture féconde du travail de Fitzpatrick N., Parrique T., Cosme I., « Exploring degrowth policy proposals: A systematic mapping with thematic synthesis », Journal of Cleaner Production, vol. 365 que nous proposons : Michel Lepesant, « Pourquoi une cartographie systémique des trajectoires de décroissance », Mondes en décroissance [En ligne], 2 | 2023, URL : http://revues-msh.uca.fr/revue-opcd/index.php?id=344. Dans ce même article, je renvoie aussi au travail de J. Moor (de) et J. Marquardt qui expliquent que l’incapacité à assumer des trajectoires longues incitent les acteurs de la transition à se replier sur le ici et maintenant : « plutôt que de poser et d’affronter la conflictualité des dissonances temporelles, la résolution consiste à spatialiser le temporel, à se replier là où peut avoir lieu une action collective ».[↩]
